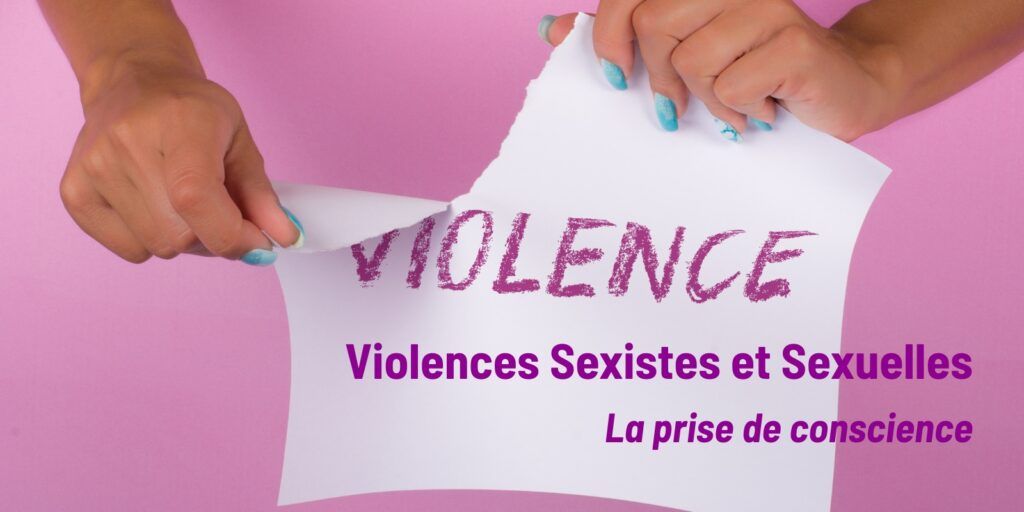De l’origine des violences sexistes et sexuelles à leur reconnaissance institutionnelle l’exposé d’un lent processus. Nous vous proposons une série d’articles :
- Article n°1 : Les racines du mal,
- Article n°2 : Des violences sexistes et sexuelles aussi en politique,
- Article n°3 : La prise de conscience,
- Article n°4 : Les propositions du PS : la convention Le temps des femmes.
La prise de conscience
Le 15 octobre 2017 éclate dans les médias l’affaire Weinstein, du nom du producteur de cinéma américain accusé de plusieurs agressions et viols. Peu de temps après, l’actrice et productrice Alyssa Milano écrit sur Twitter : If you’ve been sexually harassed or assaulted write “me too” as a reply to this tweet. Après 800 000 tweets en 24h, le #MeToo est lancé, devant un slogan de ralliement pour les victimes de VSS.
L’analyse produite par la docteure en littérature comparée Suzel Meyer et la doctorante en littérature français Salomé Pastor est très éclairante à ce propos1. Selon elles, #MeToo a occasionné une révolution morale, du fait de la grande rapidité du changement de regard sur des faits qui n’étaient pas toujours qualifiés de violences auparavant. De tels faits pouvaient être qualifiés de mœurs faisant partie de la sphère privée (le « devoir conjugal » avec l’idée que la chambre à coucher ne concerne personne d’autre), ou d’actions relevant d’une « nature masculine » (les hommes devraient assouvir des besoins primaires contre lesquels ils ne pourraient lutter). Partant de là, il a atténué l’idéologie patriarcale dominante qui nourrissait une culture du viol.
L’ampleur de cette révolution morale est en partie dûe aux mouvements féministes des années 70, dont le premier sera le Mouvement de libéralisation des femmes (MLF). Ces derniers contribuent à la formulation et la théorisation de certaines questions transversales, que sont la sexualité, la violence, le travail et le pouvoir.

A plusieurs égards, #MeToo participe donc d’une prise de conscience générale des VSS et de leur systématicité.
D’abord, l’universalité des VSS a rendu le mouvement planétaire. #MeToo a usé des réseaux sociaux pour lever les frontières géographiques et s’étendre localement sous différentes formes : #WeTooJapan au Japon, #YoSiTeCreo au Vénézuela, #EnaZeda en Tunisie, …
Ensuite, #MeToo a également levé le voile sur la nature des victimes de ces violences. Il révèle que les femmes hétérosexuelles cisgenres sont loin d’être les seules à l’encontre de qui les VSS s’exercent. Comme pour rappeler que ces violences sont en fait subies par les groupes sociaux infériorisés, se sont développés les #MeTooGay, #MeTooLesbien et #MeTooTrans.
Ainsi, le mouvement participe de la volonté de mettre un terme aux VSS systémiques et d’œuvrer en faveur d’une plus grande prise en charge des victimes aux moyens de réformes ou de lois. En France, quelques résultats législatifs peuvent être relevés, à l’instar de la promulgation d’une loi en 2018 visant à allonger le délai de prescription des
VSS2 ou d’une loi en 2021 visant à mieux protéger les mineurs des crises sexuels et de l’inceste3. A noter la très récente publication d’un rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité4.
Toutefois, quand bien même ce « moment #MeToo » a conduit à des avancées majeures en matière de droits des femmes, des limites demeurent. C’est notamment ce que révèle l’Observatoire des violences faites aux femmes5, qui note que seulement 12% d’entre elles portent plainte. Surtout, le taux de condamnation est encore aujourd’hui inférieur à 1%…

En outre, ces limites se manifestent notamment au travers de trois facteurs.
Premièrement, car toutes les victimes ne témoignent pas. Les raisons à cela sont multiples : le tabou de la sexualité, la crainte de se lancer dans des procédures judiciaires, les pressions familiales ou professionnelles, l’amnésie, la peur de ne pas être crue, la honte de ne pas avoir pu se défendre, …
Deuxièmement, du fait des « angles morts » (Kharoll-Ann Souffrant) qui heurtent certaines catégories de femmes. Sont touchées notamment les femmes noires et les femmes d’âge mûr. Dans ce cadre, l’affaire de Nafissatou Diallo et celle de Gisèle Pélicot contribuent à faire résonner leurs paroles et à mettre en lumière leurs histoires.
Troisièmement, en raison de l’inquiétant regain des revendications masculinistes. Dans son discours inaugural prononcé à l’occasion de la 69e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW69) qui s’est tenue en mars 2025 à New York, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a martelé : « les droits des femmes sont en état de siège […] le poison du patriarcat est de retour, et il revient en force ». En effet, tandis que les jeunes femmes adhèrent de plus en plus aux valeurs progressistes, les hommes du même âge ont tendance à adopter des valeurs conservatrices. Un article du Financial Times6 met en évidence, sur la base des données d’une vingtaine de pays, la progression d’un « fossé idéologique » de 30 points en six ans entre les filles et les garçons de la génération Z (désignant les personnes nées entre 1995 et 2012), notamment sur le questions d’égalité.
Cette parole collective, de plus en plus entendue mais pas toujours prise en compte, a conduit à la publication en mai 2024 de la tribune « Qui nous écoute vraiment ? »7, dans laquelle plus de cent personnalités exigent une loi intégrale et ambitieuse contre les VSS en France.
In fine, #MeToo interroge plus largement, outre la capacité d’écoute des victimes, les moyens dont dispose le système judiciaire et les modes alternatifs de justice à l’instar de la justice restaurative.
Bibliographie
- #MeToo | ITI Lethica | Littératures, éthique & arts.
- LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1) – Légifrance
- LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste (1) – Légifrance
- Tome I – Rapport d’enquête – 17e législature – Assemblée nationale
- Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes
- Fractures françaises : #MeToo, une prise de conscience collective face aux violences sexistes et sexuelles – Fondation Jean-Jaurès
- Fractures françaises 2022 – Fondation Jean Jaurès
- Chronologie des droits des femmes | vie-publique.fr